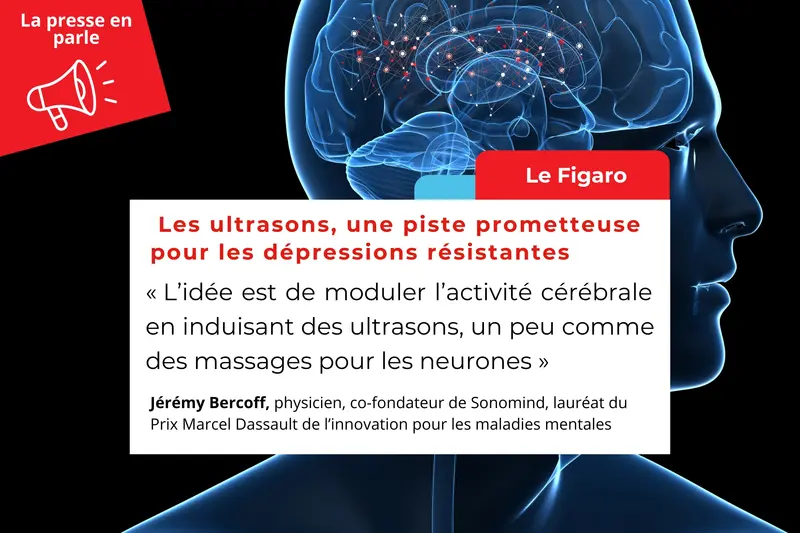Faut-il intégrer l’inflammation comme un critère diagnostic de certaines formes de dépression dans le futur DMS-6 ?
Alors que les travaux sont en cours sur la prochaine édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-6), une question cruciale émerge : faut-il intégrer certains mécanismes biologiques, comme l’inflammation, dans les critères de stratification diagnostiques de la dépression ?
C’est la proposition que nous formulons dans un article publié dans JAMA Psychiatry en mars 2025, coécrit avec Manish K. Jha, Professeur associé en psychiatrie au Centre de recherche et de soins cliniques sur la dépression de l’UT Southwestern Medical Center (Texas, USA), Carmine M. Pariante, Professeur de psychiatrie biologique au King’s College de Londres, et Andrew H. Miller, Professeur de psychiatrie et de sciences du comportement, Vice-président de la recherche au Département de psychiatrie et de sciences du comportement et Directeur du programme d’immunologie comportementale de l’École de médecine de l’Université Emory (Georgie, USA).
Ce que dit la recherche
Notre conviction repose sur un ensemble de résultats scientifiques solides, qui montrent qu’un sous-groupe de patients déprimés présente une inflammation chronique de bas grade. Cela signifie que leur système immunitaire est activé, même s’ils ne sont pas malades physiquement. On le détecte notamment grâce à certains marqueurs sanguins de l’inflammation comme la CRP (C-réactive protéine) ou des substances appelées cytokines, comme l’interleukine-6 (IL-6) ou le Tumor Necrosis Factor (TNF).
Ces patients ont des symptômes dépressifs bien particuliers : fatigue persistante, perte de plaisir (anhédonie), troubles du sommeil ou de l’appétit, mais aussi ralentissement psychomoteur. Ces symptômes ressemblent à ce que les chercheurs appellent le «comportement de maladie», qu’on observe chez l’humain mais aussi chez les animaux : ils se mettent au repos, mangent moins, sont moins actifs… Des réactions normales qui surviennent en cas d’infection et aident à guérir, mais qui peuvent devenir problématiques lorsqu’elles s’installent durablement.
Plusieurs études ont aussi observé que l’inflammation agit sur certaines zones du cerveau impliquées dans la motivation, le plaisir et l’activité. Par exemple, elle peut réduire l’effet de la dopamine (la molécule du plaisir) dans le cerveau. Cela explique pourquoi certaines personnes déprimées ont du mal à ressentir de la joie ou à se motiver, et ce malgré les traitements. Les patients déprimés présentant une inflammation chronique répondent en effet moins bien aux antidépresseurs traditionnels.
Un impact concret pour les patients, avec des traitements plus personnalisés
En revanche, ils pourraient mieux réagir à d’autres traitements, comme une thérapie combinant des médicaments anti-inflammatoires à un traitement antidépresseur, des traitements qui renforcent l’activité de la dopamine, la molécule du plaisir et de la motivation, ou des approches psychothérapeutiques. Des essais cliniques ont aussi montré que des thérapies comme la kétamine ou l’électroconvulsivothérapie (ECT) peuvent être plus efficaces chez les personnes présentant une inflammation.
Mesurer les marqueurs biologiques de l’inflammation pourrait donc permettre d’identifier ce sous-groupe de patients et d’adapter les traitements en conséquence. L’un des grands avantages de cette approche est qu’elle repose sur des analyses de sang simples et disponibles en laboratoire. Par exemple, la CRP est couramment utilisée en médecine pour évaluer les risques cardiovasculaires. Si on l’utilisait aussi pour mieux stratifier la dépression, on pourrait adapter les traitements aux caractéristiques biologiques de chaque patient, une démarche appelée psychiatrie de précision.
En résumé, intégrer un critère lié à l’inflammation dans le diagnostic de la dépression aiderait à proposer des traitements plus personnalisés et efficaces. Cela permettrait ainsi d’ouvrir la voie à une psychiatrie plus précise et individualisée, s’attaquant aux causes biologiques des symptômes et non seulement à leurs manifestations visibles.