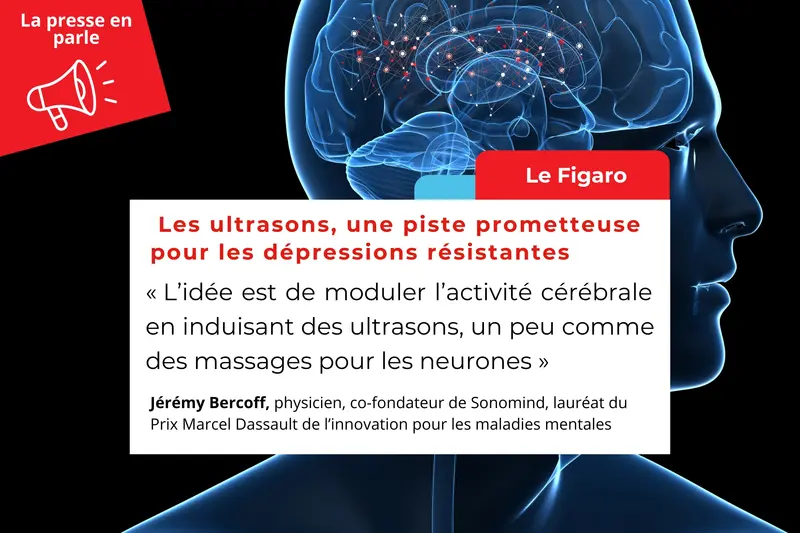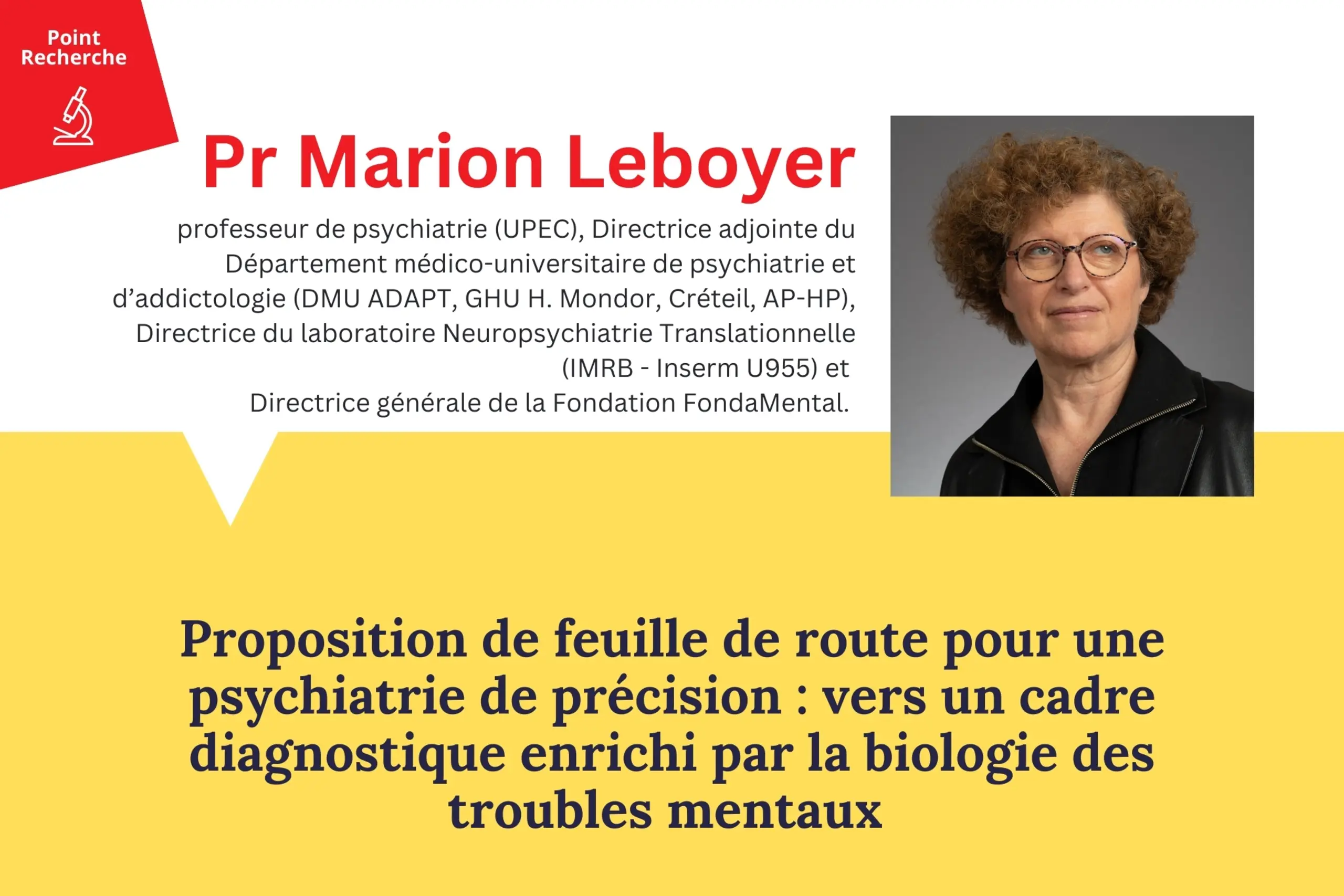
Proposition de feuille de route pour une psychiatrie de précision : vers un cadre diagnostique enrichi par la biologie des troubles mentaux
Marion Leboyer, professeur de psychiatrie (UPEC), Directrice adjointe du Département médico-universitaire de psychiatrie et d’addictologie (DMU ADAPT, GHU H. Mondor, Créteil, AP-HP), Directrice du laboratoire Neuropsychiatrie Translationnelle (IMRB - Inserm U955) et Directrice générale de la Fondation FondaMental.
Le Collège européen de neuropsychopharmacologie (ECNP) a lancé, en collaboration avec un large groupe international composé de psychiatres, de chercheurs, de patients et d’industriels, une initiative d’envergure destinée à transformer les stratégies diagnostiques des maladies mentales. Son objectif : moderniser les méthodes actuelles en y intégrant des données mesurables, objectives et quantifiables, afin de dépasser les limites d’un système encore largement fondé sur la seule description subjective de symptômes comportementaux.
Une « Feuille de route pour une psychiatrie de précision », reflet de cette initiative, a été publiée le 19 juin 2025 dans la revue Molecular Psychiatry. Coordonnée par le professeur Martien Kas, de l’université de Groningen (Pays-Bas), elle pourrait marquer un tournant décisif pour la discipline, à l’image des progrès en médecine de précision accomplis dans d’autres domaines médicaux comme les cancers ou les maladies neuro-dégénératives.
Aujourd’hui, le diagnostic des troubles mentaux repose principalement sur deux manuels de référence : le DSM (Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, élaboré par l’American Psychiatric Association) et la CIM (Classification internationale des maladies, mise en place par l’Organisation mondiale de la santé). Ces classifications décrivent les troubles mentaux à partir des symptômes observés ou rapportés en clinique. Cependant, cette approche présente plusieurs limites. Bien que l’utilisation de ces classifications ait amélioré la fidélité des diagnostics entre différents professionnels, les catégories de troubles restent très hétérogènes, chevauchantes et non validées.
Pour dépasser ces obstacles, la feuille de route de l’ECNP propose d’enrichir l’évaluation clinique par des données objectives, quantifiables, mesurables. Cela pourrait inclure des marqueurs biologiques, des examens d’imagerie cérébrale ou d’electrophysiologie, ou encore des données recueillies via des objets connectés — par exemple pour suivre des indicateurs du sommeil, de l’activité physique ou les rythmes de vie. Ces éléments permettraient d’identifier des profils clinico-biologiques spécifiques, afin de mieux adapter les traitements existants et de guider le développement de nouvelles stratégies thérapeutiques.
Ce changement ne se fera pas du jour au lendemain. La feuille de route prévoit une coordination internationale pour aligner les méthodes et les outils, la mise au point de biomarqueurs fiables capables de prédire la réponse aux traitements, ainsi qu’une intégration progressive de ces données dans les grandes classifications internationales comme le DSM et la CIM. L’ambition est de bâtir un cadre souple, évolutif, et capable de s’adapter aux découvertes scientifiques à venir.
Cette feuille de route marque un tournant dans la compréhension et la prise en charge des troubles mentaux. À terme, elle ouvre la voie à une médecine plus précise et plus personnalisée, où chacun pourra bénéficier du bon traitement, au bon moment.