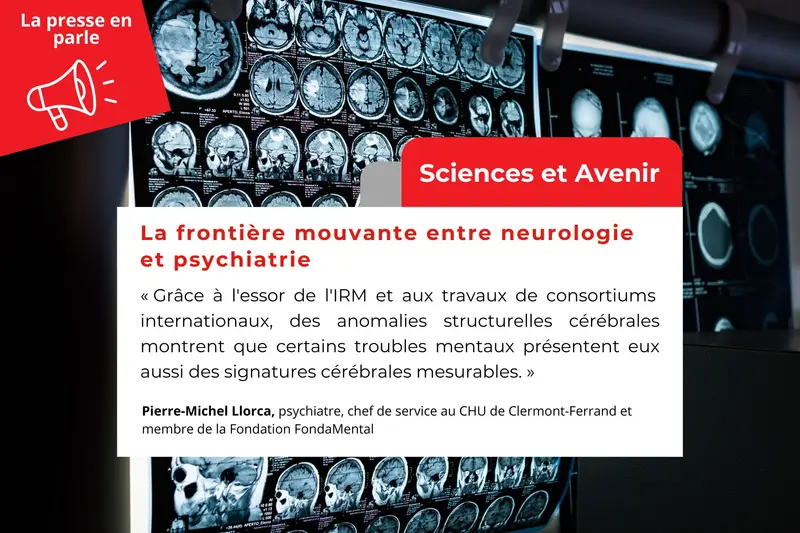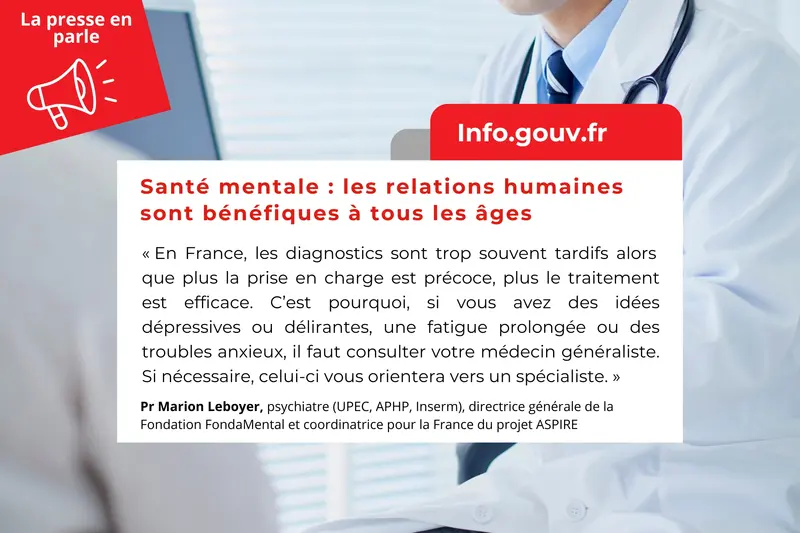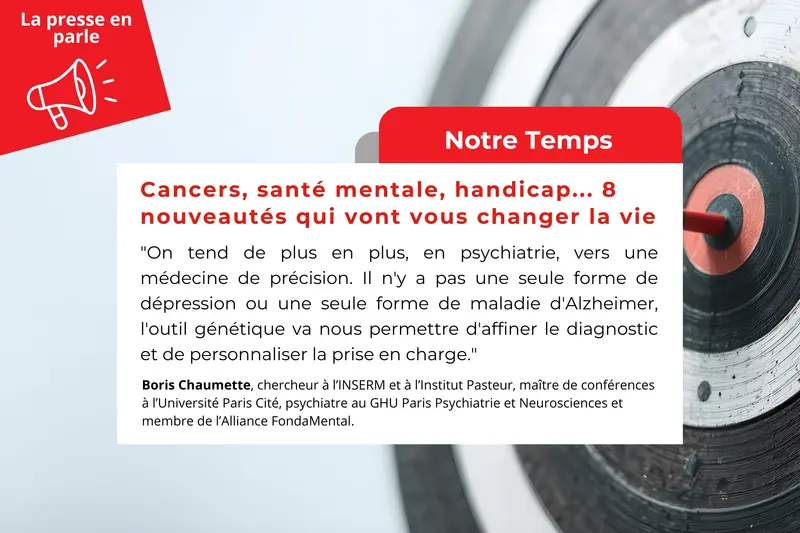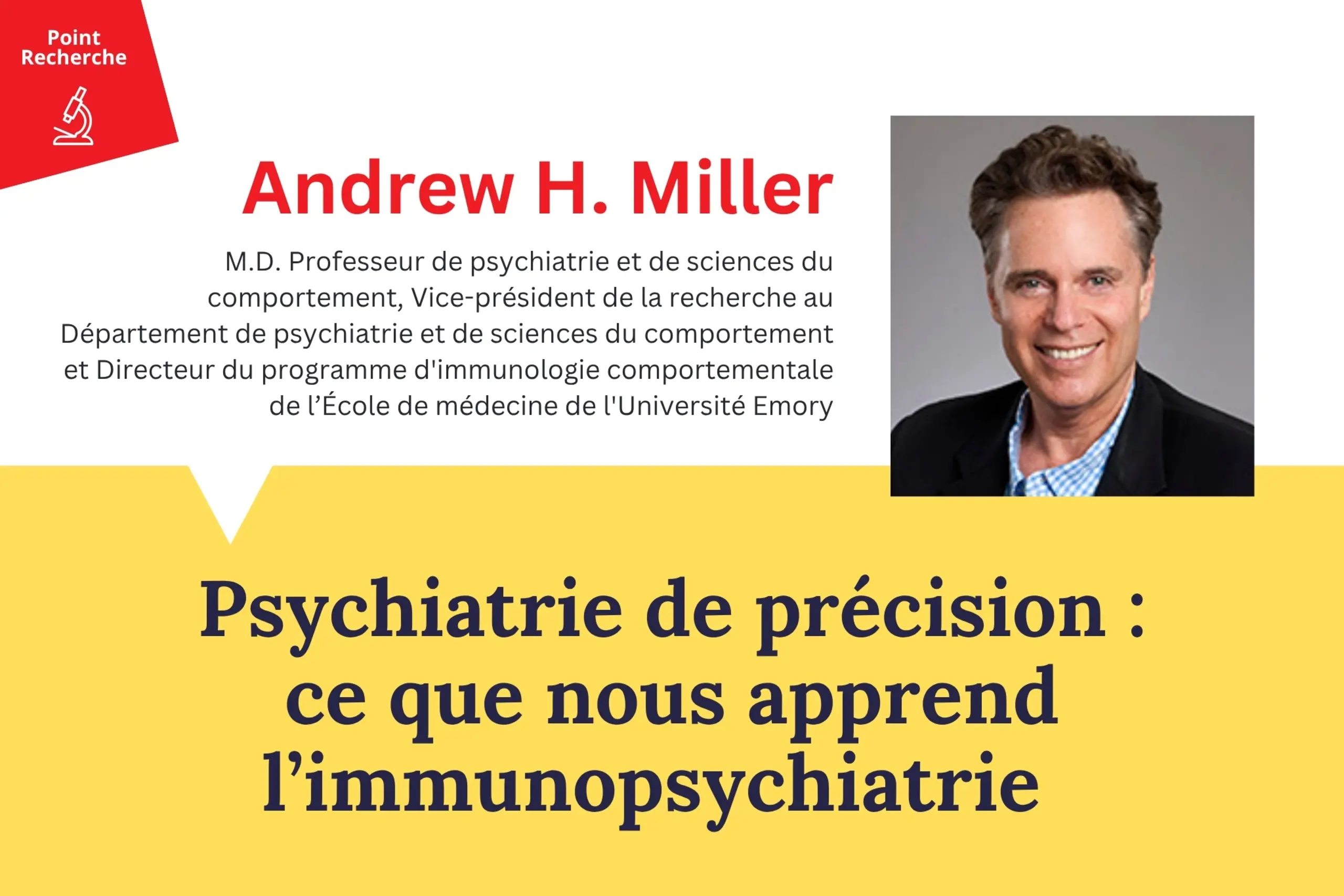
Psychiatrie de précision : ce que nous apprends l’immunopsychiatrie
Andrew H. Miller
M.D. Professeur de psychiatrie et de sciences du comportement, Vice-président de la recherche au Département de psychiatrie et de sciences du comportement et Directeur du programme d’immunologie comportementale de l’École de médecine de l’Université Emory.
Vers une psychiatrie de précision
Pendant des décennies, les personnes souffrant de dépression, de schizophrénie et d’autres troubles similaires ont eu recours à des traitements malheureusement peu spécifiques et imprévisibles. La plupart des médicaments psychotropes ont été découverts par hasard il y a plusieurs décennies, ne sont efficaces que pour environ un tiers des patients et sont prescrits par tâtonnements, faute de tests biologiques précis permettant de prédire quel médicament sera efficace pour quel patient.
Parallèlement, les neurosciences ont réalisé d’énormes progrès dans la cartographie des gènes, des circuits cérébraux et des messagers chimiques impliqués dans les maladies mentales. La psychiatrie de précision propose d’exploiter cette richesse de connaissances biologiques pour révolutionner le diagnostic et le traitement des maladies mentales, tout comme les traitements contre le cancer sont désormais adaptés à la biologie spécifique de la tumeur de chaque patient.
L’immunopsychiatrie, une voie prometteuse
Sous-branche de la psychiatrie de précision, l’immunopsychiatrie explore l’influence du système immunitaire sur le cerveau et le comportement. Des recherches ont révélé qu’environ un tiers des personnes souffrant de dépression, ainsi que de nombreuses personnes souffrant d’autres troubles psychiatriques, présentent des niveaux élevés d’inflammation. Des expériences montrent que les molécules inflammatoires libérées par le système immunitaire peuvent perturber les centres cérébraux de la motivation et de l’activité motrice, entraînant des symptômes d’apathie, de fatigue et de ralentissement psycho-moteur. Fait encourageant, des recherches préliminaires suggèrent également que les médicaments ciblant l’inflammation peuvent inverser ces symptômes.
Pourtant, malgré ces fondements scientifiques convaincants, les premiers essais de traitements anti-inflammatoires contre la dépression ont produit des résultats contradictoires. Des critiques ont même remis en question le bien-fondé de cette approche. Cependant, les chercheurs affirment que ces problèmes ne sont pas dus à la faiblesse des données scientifiques, mais à l’obsolescence des méthodes d’essais cliniques. La plupart des études ont recruté tous les patients présentant un diagnostic général de dépression, sans vérifier s’ils présentaient réellement une inflammation. Elles ont également mesuré le l’efficacité thérapeutique à l’aide d’échelles cliniques regroupant de nombreux symptômes sans rapport entre eux, alors que l’inflammation n’affecte qu’un sous-ensemble spécifique de symptômes. Par conséquent, de nombreux essais n’ont pas réussi à confirmer l’efficacité des traitements pour réduire l’inflammation. Les effets prometteurs de ces traitements anti-inflammatoires pour les patients présentant une inflammation ont donc été masqués par la majorité d’autres patients ne présentant aucune inflammation à cibler.
Psychiatrie de précision et immunopsychiatrie : un effort collectif
Nous proposons une évolution vers des essais plus intelligents, axés sur la biologie. Au lieu d’inclure tous les patients avec un diagnostic général, les essais devraient inclure uniquement ceux dont les analyses sanguines ou l’imagerie cérébrale montrent des signes d’inflammation. Plutôt que de se limiter à des listes de symptômes générales, les essais devraient mesurer l’évolution des symptômes les plus directement influencés par l’inflammation, tels que la perte de motivation, la fatigue ou le ralentissement psychomoteur. De nouveaux concepts diagnostiques, comme la « dépression d’origine immunitaire », pourraient mieux refléter la réalité biologique de ces patients. Il est crucial que les traitements démontrent qu’ils parviennent véritablement à modifier les voies biologiques qu’ils visent à influencer. La mise en œuvre de cette nouvelle approche, et plus globalement de la psychiatrie de précision, nécessitera un effort collectif. Les autorités réglementaires doivent soutenir les essais conçus autour de biomarqueurs spécifiques et de nouvelles mesures de résultats. Les assureurs doivent prendre en charge le coût des tests diagnostiques. Les laboratoires pharmaceutiques ont besoin d’incitations pour développer et réorienter les médicaments ciblant l’inflammation. Chercheurs, cliniciens et patients doivent collaborer pour identifier les symptômes les plus pertinents.
L’immunopsychiatrie, avec ses cibles biologiques claires et ses stratégies d’essais cliniques innovantes, offre un modèle prometteur pour la psychiatrie qui peut dépasser le traitement par tâtonnements et offrir des soins personnalisés et adaptés au profil biologique unique de chaque patient.