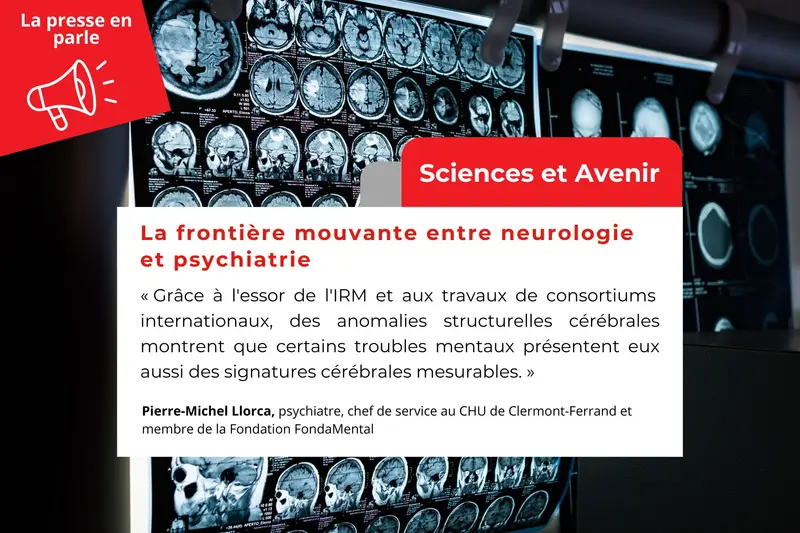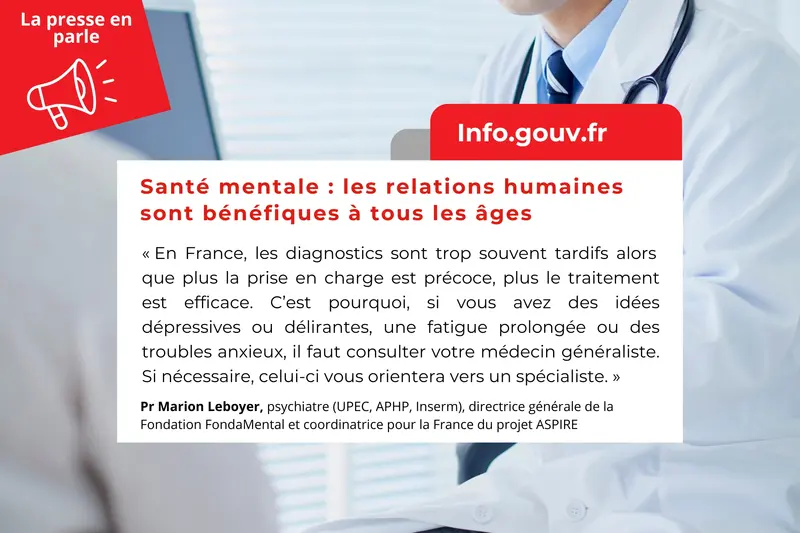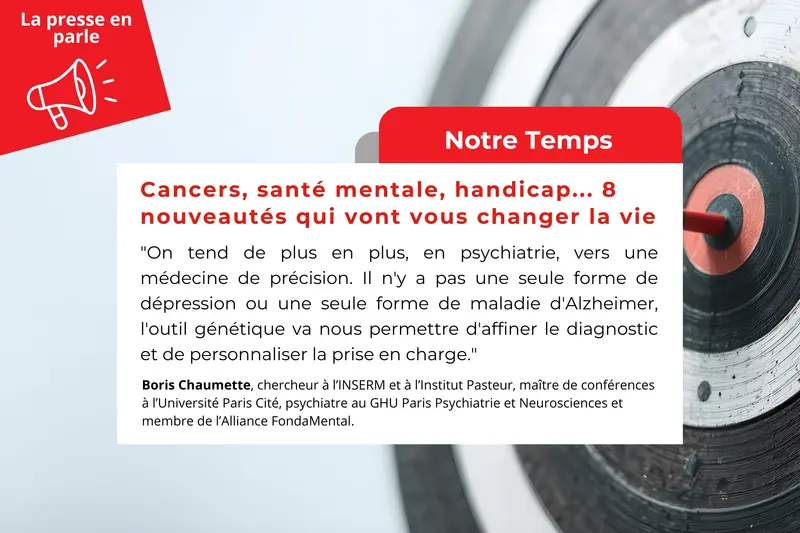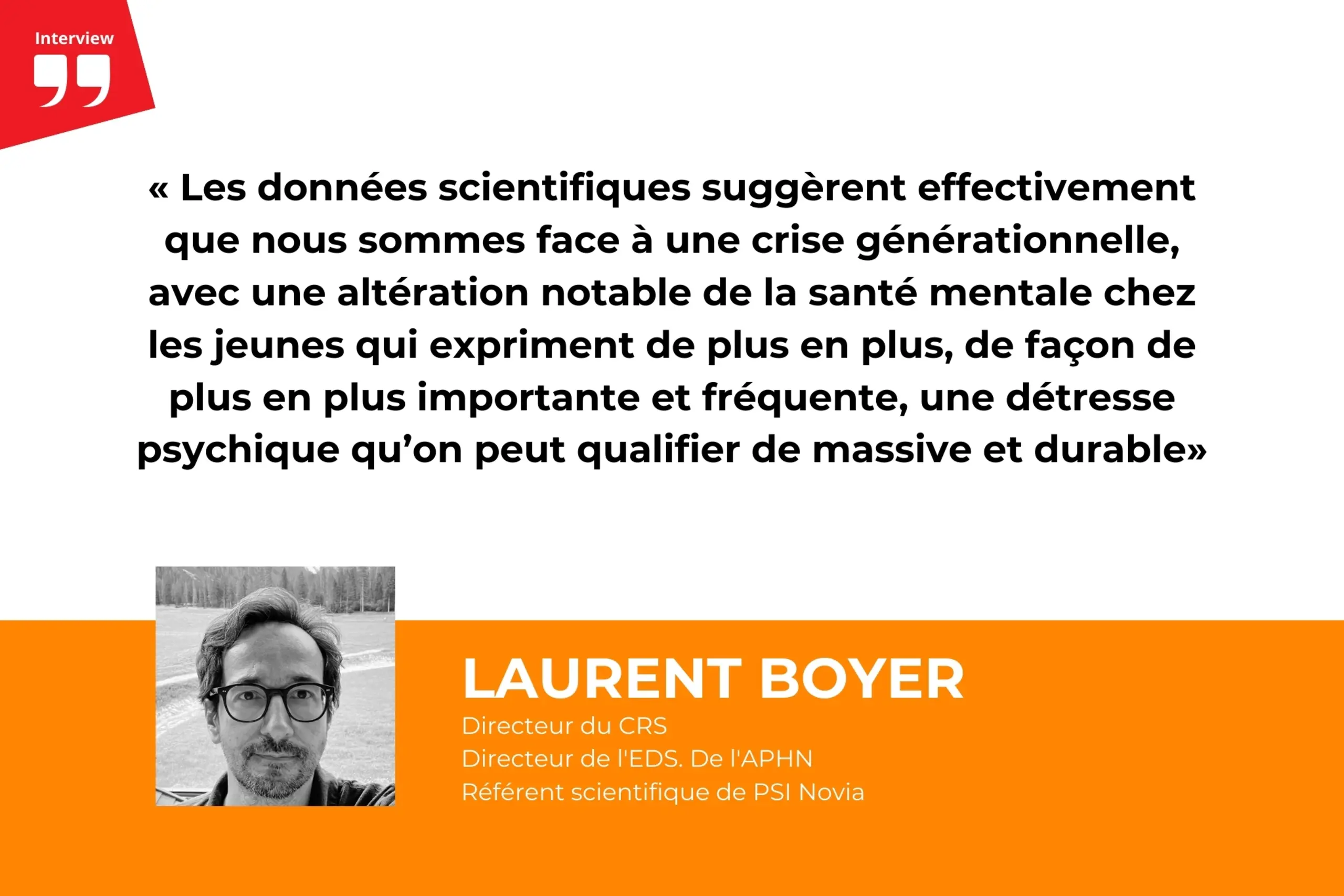
Laurent Boyer
Directeur du CRS, directeur de l’EDS, de l’APHN et référent scientifique de PSI Novia
L’objectif n’est pas de remplacer la psychiatrie par le numérique, mais bien de penser une psychiatrie augmentée par le numérique et l’IA.
Les jeunes ont été parmi les plus durement touchés par la crise du Covid-19 sur le plan psychique. Aujourd’hui, la jeunesse traverse-t-elle une «crise générationnelle» de santé mentale ?
Oui, les données scientifiques suggèrent que nous sommes effectivement face à une crise générationnelle de santé mentale, avec une altération notable de la santé mentale chez les jeunes, qui expriment une détresse psychique de plus en plus fréquente, massive et durable.
La pandémie de Covid-19 a joué un rôle de catalyseur, en mettant en lumière une fragilité déjà existante. Elle a amplifié des problématiques présentes auparavant, notamment l’isolement, l’incertitude et la rupture des repères sociaux et scolaires. Mais il ne s’agit pas uniquement d’un phénomène conjoncturel : c’est un phénomène structurel, qui s’est amorcé avant la pandémie, s’est accentué avec elle, et ne cesse de s’aggraver.
Cette génération a été confrontée très tôt à des crises successives : la pandémie bien sûr, mais aussi l’urgence climatique, l’anxiété sociale et, plus récemment, l’impact des réseaux sociaux – dont le rôle dans ce malaise psychique croissant mérite d’être interrogé.
Les chiffres clés sont sans appel :
– Selon l’enquête CoviPrev de Santé publique France (2022–2023), chez les 18-24 ans, près de 30 % déclarent des symptômes dépressifs modérés à sévères, et plus de 35 % présentent des symptômes d’anxiété. Ces taux sont deux à trois fois supérieurs à ceux mesurés avant la pandémie.
– Le baromètre santé mentale jeunes Franciliens (Harris Interactive – FondaMental, fin 2024) rapporte que 50 % des jeunes présentaient des symptômes dépressifs, 40 % des symptômes anxieux, et 32 % déclaraient avoir eu des pensées suicidaires dans les 12 derniers mois.
– Une étude nationale de grande ampleur, menée à partir des données du SNDS (Système national des données de santé) et analysée par le CEReSS, confirme une augmentation progressive du recours aux soins psychiatriques et de la prescription de psychotropes chez les jeunes de moins de 25 ans notamment chez les jeunes filles.
Il est important de noter que cette augmentation ne peut être attribuée à une amélioration de l’offre de soins, qui au contraire se dégrade. L’hypothèse la plus probable est donc une hausse réelle de la prévalence des troubles psychiques dans cette classe d’âge.
En résumé, nous sommes bien face à une crise générationnelle durable, dont les racines sont profondes et multiples, et qui exige une réponse ambitieuse, structurelle et coordonnée.
Quelles sont les pathologies ou formes de souffrance psychique les plus fréquentes chez les adolescents et les jeunes adultes ? Quels signaux doivent alerter les familles, les enseignants ou les soignants ?
Ce qu’il faut d’abord avoir en tête, c’est que la moitié des troubles psychiatriques débutent avant l’âge de 15 ans, et un quart entre 15 et 25 ans. C’est donc une période clé pour la prévention et l’intervention précoce.
Les troubles les plus fréquents à ces âges sont :
– Les troubles anxieux ;
– Les dépressions ;
– Les troubles du comportement alimentaire ;
– Les addictions ;
– Les troubles du spectre de l’autisme et le TDAH, qui sont souvent non diagnostiqués, sous-diagnostiqués ou diagnostiqués tardivement.
Les signaux d’alerte auxquels doivent être attentifs les familles, les enseignants et les professionnels de première ligne sont :
– Isolement ;
– Perte d’intérêt ;
– Troubles du sommeil ;
– Repli sur soi ;
– Changement brutal de comportement ;
– Idées noires, scarifications ;
– Et bien sûr, le décrochage scolaire, qui constitue un indicateur majeur de souffrance psychique.
Il est donc essentiel que les familles, les enseignants, les soignants, ainsi que l’ensemble des acteurs de première ligne, soient formés à reconnaître ces signes afin de pouvoir intervenir le plus tôt possible. Cela suppose de les former, outiller, accompagner, pour qu’ils puissent repérer sans culpabiliser ni stigmatiser, et surtout orienter efficacement vers les structures ou professionnels adaptés.
Jusqu’à récemment, l’un des obstacles majeurs était l’absence d’outils de formation à grande échelle. Mais aujourd’hui, les technologies numériques et l’intelligence artificielle, y compris les agents conversationnels, ouvrent la voie à des solutions innovantes pour former massivement et rapidement ces acteurs clés, avec un impact potentiel majeur sur la prévention et le repérage précoce.
La Fondation FondaMental mène depuis 2022 le programme QIM Cassandre en Île-de-France. Quels sont les premiers résultats tangibles de ce programme, notamment en termes de détection précoce ou de prévention ?
Le programme QIM Cassandre a été lancé en 2022 avec le soutien de la Région Île-de-France, afin de répondre à l’urgence de santé mentale chez les jeunes, en particulier les 18-30 ans. Il repose sur quatre piliers fondamentaux : la détection, l’évaluation, l’orientation et la prise en charge des jeunes en souffrance psychique.
Parmi les premiers résultats concrets, on peut citer :
– La réalisation d’un baromètre régional sur trois ans, que j’ai piloté (publié dans le Journal d’Addictologie et de Formation en psychiatrie), qui a permis de suivre l’évolution des troubles mentaux chez les jeunes Franciliens. Les chiffres sont élevés et constants (voir 1ère question).
– Une étude épidémiologique à partir de l’entrepôt de données de santé (EDS) de l’AP-HP a permis de mesurer la prévalence des tentatives de suicide chez les jeunes Franciliens. Elle révèle une augmentation préoccupante des idées suicidaires et des passages à l’acte, en particulier chez les jeunes filles : 80 % des tentatives de suicide chez les moins de 15 ans concernent des adolescentes.
– Le programme a également permis de développer ou renforcer plusieurs outils numériques :
– Écoute Étudiants Île-de-France (lancée en 2021 pendant la crise Covid), une plateforme d’autodiagnostic et de ressources d’accompagnement.
– My-Mood (2025), son évolution, qui propose une plateforme plus complète avec des recommandations personnalisées, des contenus éducatifs (vidéos, podcasts) et une carte interactive des dispositifs d’aide disponibles en Île-de-France.
Enfin, QIM Cassandre permet de fédérer durablement chercheurs, cliniciens, collectivités territoriales et acteurs de terrain autour d’un objectif commun : améliorer concrètement les parcours de soin des jeunes en situation de souffrance psychique. Cette dynamique collaborative redonne également du sens à l’action des professionnels, en les inscrivant dans un projet structurant et durable de transformation du soin.
Comment analysez-vous les usages actuels des outils numériques par les jeunes pour leur santé mentale, entre recours à ces technologies comme soutien et risques liés à leur utilisation excessive ou inadaptée ?
C’est une question centrale, et qui nécessite de faire preuve de nuance. Le numérique joue aujourd’hui un double rôle.
D’un côté, il constitue un facteur de risque clairement établi :
– Il favorise l’exposition aux comparaisons sociales,
– Le cyberharcèlement,
– La désinformation en santé.
Ces usages alimentent l’anxiété, le mal-être, les troubles du sommeil, et contribuent à l’augmentation des troubles observés chez les jeunes. On constate d’ailleurs une corrélation temporelle entre l’apparition des premiers smartphones, l’essor des réseaux sociaux et la montée des troubles de santé mentale dans cette population.
Mais d’un autre côté, le numérique peut aussi être un levier, à condition d’être encadré, éthique, et surtout validé scientifiquement. C’est un point essentiel : il existe aujourd’hui une offre numérique très large, mais peu lisible. Beaucoup d’outils sont disponibles, mais tous ne sont pas fiables. La validation scientifique doit être un prérequis, sans quoi ces dispositifs risquent de faire plus de mal que de bien.
Pourquoi les jeunes se tournent-ils vers ces solutions ?
Parce que ces outils :
– Sont disponibles 24h/24,
– Discrets,
– Accessibles, souvent gratuits,
– Et ils parlent leur langage : formats courts, gamifiés, ludiques, en phase avec la culture du self-care portée par les réseaux sociaux.
C’est aussi une réponse à un constat très concret : le système de soins est saturé, et les ressources sont inégalement réparties, en particulier dans les zones sous-dotées. Le numérique peut alors jouer un rôle complémentaire, à condition de ne pas se substituer au soin.
Mais attention :
– Ces outils ne remplacent ni le diagnostic clinique ni la relation thérapeutique.
– Beaucoup d’applications ne sont pas encadrées, et certaines diffusent des contenus peu fiables, voire dangereux.
– Il faut donc structurer le paysage numérique de manière cohérente, et soutenir les outils validés scientifiquement.
C’est un enjeu de santé publique et de politique territoriale. Certaines ARS, comme en région PACA, travaillent déjà à une structuration du numérique en santé mentale à l’échelle locale, en lien avec les acteurs du soin.
L’objectif n’est pas de remplacer la psychiatrie par le numérique, mais bien de penser une psychiatrie augmentée par le numérique et l’IA.
L’humain doit rester au cœur de la prise en charge.
Quels messages souhaitez-vous adresser aux pouvoirs publics pour faire de la santé mentale des jeunes une véritable priorité politique ?
Il est urgent de sortir d’une logique d’urgence ponctuelle, souvent réactive, pour adopter une stratégie globale, durable et intersectorielle.
La santé mentale des jeunes ne peut plus être traitée comme une succession de crises, mais doit s’inscrire dans une politique publique cohérente, construite sur le long terme.
Cela implique plusieurs leviers majeurs :
– Investir massivement dans la prévention dès le plus jeune âge.
De nombreux programmes internationaux ont démontré leur efficacité dès l’école primaire. Il faut s’en inspirer et déployer des actions pérennes, structurées autour d’une véritable culture du bien-être psychique à l’école.
– Créer des passerelles efficaces entre les dispositifs scolaires, universitaires, médicaux et sociaux.
Aujourd’hui, l’orientation est souvent chaotique, et les jeunes, en particulier les plus vulnérables, passent entre les mailles du filet. Une coordination intersectorielle est indispensable pour fluidifier les parcours.
– Renforcer les moyens humains dans les structures de soins, et former davantage les professionnels à la spécificité de l’adolescence et à la transition vers l’âge adulte.
Cette phase de transition est un point de bascule critique dans les parcours de soins : elle est souvent mal accompagnée, ce qui peut compromettre la continuité thérapeutique. Ce constat vaut pour l’ensemble des maladies chroniques, mais il est particulièrement aigu dans les troubles psychiatriques.
– Soutenir les innovations numériques, à condition qu’elles soient encadrées et validées scientifiquement.
Ces outils permettent de toucher les jeunes autrement, via leurs canaux et leurs codes. Mais leur intégration dans les parcours de soins suppose des critères clairs d’évaluation, de sécurité et de fiabilité. Il s’agit là d’un enjeu scientifique et éthique, mais aussi d’un défi politique, notamment en lien avec les ARS.
– Lutter activement contre la stigmatisation voire contre les discriminations liées à la santé mentale.
Tant que ces sujets resteront tabous, les jeunes continueront de souffrir en silence. Il faut changer les représentations collectives, valoriser la parole des jeunes et promouvoir une approche décomplexée et bienveillante de la santé mentale, au même titre que la santé physique.