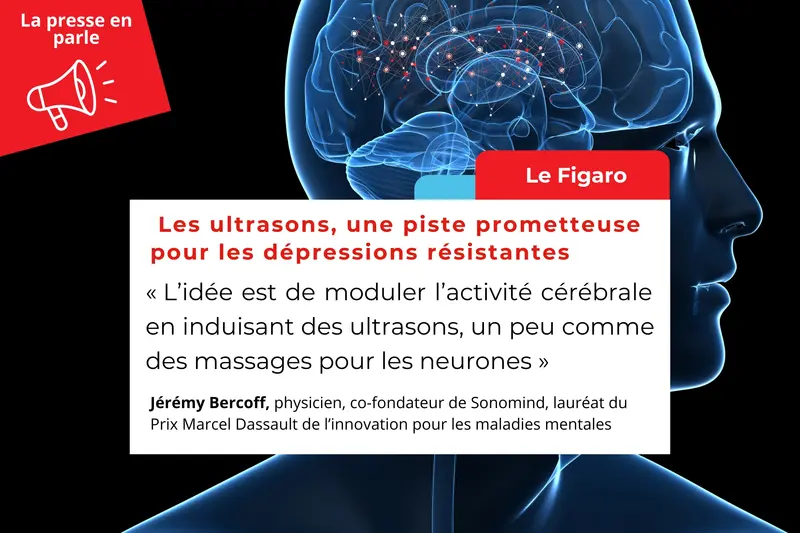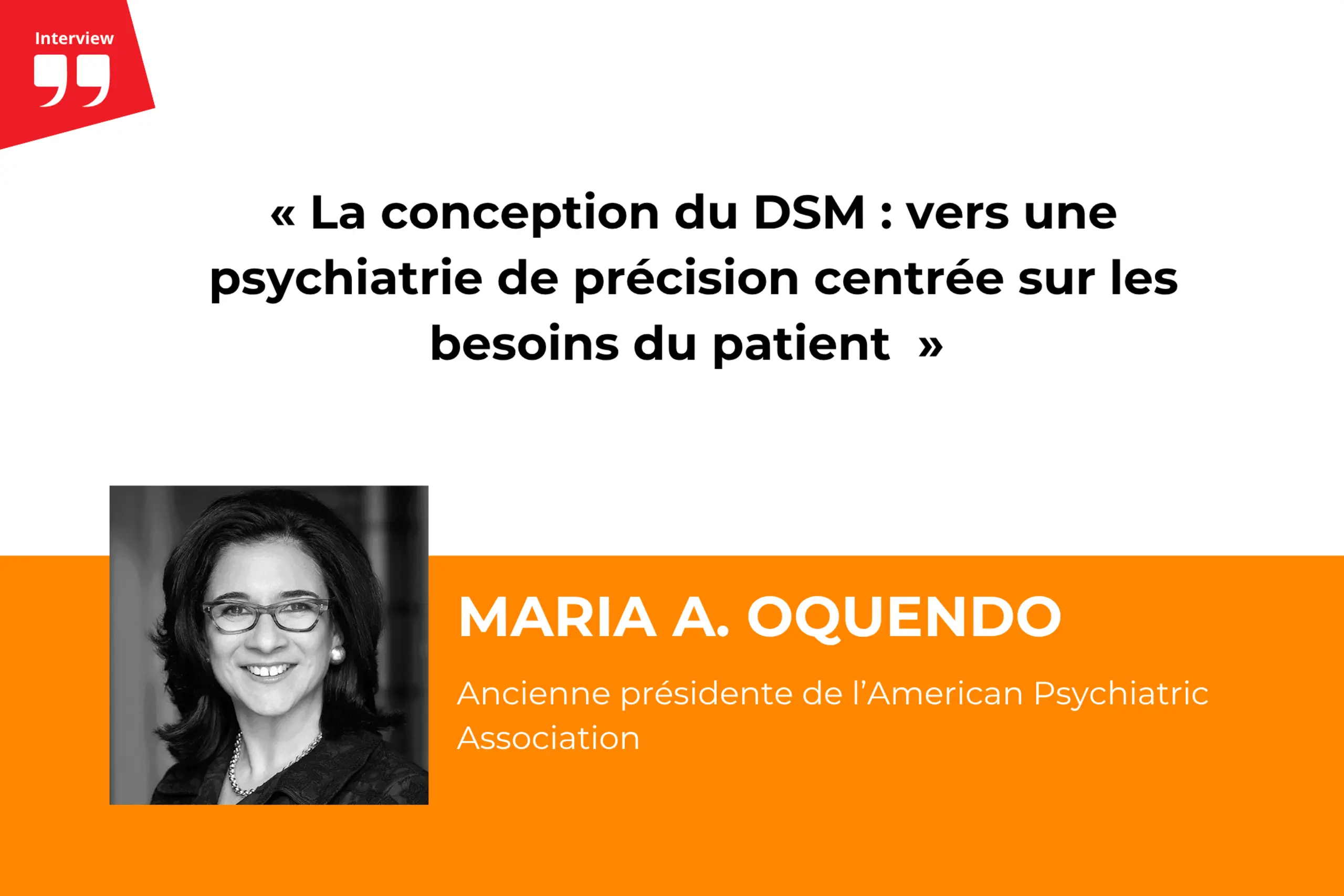
La conception du DSM : vers une psychiatrie de précision centrée sur les besoins du patient
L’objectif actuel est d’examiner comment des indicateurs biologiques, comme des signatures génétiques, des biomarqueurs ou l’imagerie cérébrale, pourraient contribuer à affiner les diagnostics ou à définir des sous-types pertinents de troubles.
Le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) est la principale référence utilisée par les professionnels de santé mentale du monde entier pour diagnostiquer les troubles psychiatriques. Depuis sa première édition en 1952, il a évolué pour refléter les avancées scientifiques et les évolutions sociétales liées à la compréhension des maladies mentales. En se basant sur des critères standardisés et des symptômes observables, le DSM a façonné la pratique psychiatrique dans des contextes cliniques variés et reste un outil central pour la recherche, les traitements et les politiques de santé.
Alors que les travaux sur la prochaine version du DSM débutent, la psychiatre Maria A. Oquendo, ancienne présidente de l’American Psychiatric Association et figure de proue de la santé mentale à l’échelle mondiale, joue un rôle clé dans l’orientation des travaux. Nous lui avons demandé d’expliquer les principaux défis à venir et la manière dont le comité repense les fondements mêmes du diagnostic psychiatrique.
Pourriez-vous expliquer le rôle du DSM dans la pratique psychiatrique à l’échelle mondiale, et comment sa structure et sa finalité ont évolué depuis sa première édition pour s’adapter aux découvertes scientifiques et aux changements sociétaux ?
Le DSM a joué un rôle important à l’échelle mondiale en se focalisant sur les symptômes observables et faisant en sorte de définir les diagnostics avec un niveau de précision inégalé des systèmes diagnostiques antérieurs. Son approche structurée et codifiée a facilité son adaptation et son application dans divers contextes internationaux.
Comparé aux premières versions de la CIM (ndlr : Classification internationale des maladies, publiée par l’Organisation mondiale de la santé), le DSM a été particulièrement utile pour détailler clairement les critères nécessaires à l’établissement d’un diagnostic. Avant la CIM-11, la CIM consistait principalement en des codes diagnostiques et des qualificatifs, sans description détaillée des troubles.
Cela a changé avec l’introduction de la CIM-11, qui inclut désormais des lignes directrices diagnostiques plus complètes. L’un de nos objectifs actuels est de faire en sorte que notre travail soit aligné avec le cadre de la CIM et qu’il complète cet outil de référence mondial essentiel.
La psychiatrie a beaucoup évolué ces dernières décennies, avec les avancées en neurosciences et en génétique, et une prise de conscience croissante des déterminants sociaux et environnementaux de la santé. Comment ces évolutions influencent-elles la vision stratégique du comité pour la prochaine version du DSM ?
La psychiatrie a connu plusieurs avancées majeures, notamment dans notre compréhension de la physiopathologie. Ces progrès ont mis en lumière une limite importante : les diagnostics du DSM ne sont pas aussi précis que nous le souhaiterions, ni aussi précis que ce que suppose souvent le grand public.
L’une des questions centrales que nous explorons actuellement est la pertinence des frontières dressées entre les différentes catégories diagnostiques. Evaluer cette pertinence est essentiel dans le cadre de la prochaine version du DSM.
Un défi majeur tient au fait que le DSM est un outil utilisé en soins cliniques, dans la prise en charge du patient. Toute modification doit donc être soigneusement pensée pour ne pas perturber la pratique clinique au détriment du patient.
Même des ajustements conceptuels apparemment simples peuvent avoir des conséquences importantes pour les patients. C’est pourquoi chaque révision proposée doit être abordée avec prudence et un fort sens des responsabilités.
L’un des objectifs du comité stratégique du DSM est d’explorer la psychiatrie de précision par l’intégration de données biologiques, y compris les biomarqueurs et les indicateurs génétiques. Quelles sont les considérations scientifiques et cliniques majeures qui guident cette intégration ? Comment cette approche pourrait-elle améliorer la précision des diagnostics pour des symptômes transdiagnostiques tels que l’anxiété, les troubles du sommeil ou les déficits cognitifs ? Et quel impact pourrait-elle avoir sur la personnalisation des traitements, la qualité de vie à long terme et la prise de décision clinique à travers les systèmes de santé ?
L’American Psychiatric Association s’est engagée activement dans des collaborations avec l’ECNP et d’autres scientifiques de premier plan dans le monde, soulignant l’importance d’une diversité de perspectives internationales dans ce processus.
Alors que le développement du DSM-5 a pris environ dix ans, l’ambition est désormais de finaliser la prochaine version dans un délai plus court, un objectif qui reste néanmoins ambitieux. Durant sa première année de travaux, le comité a identifié et approfondi plusieurs axes stratégiques structurants, reflétant la vision portée par le futur manuel.
L’un des grands sujets de réflexion concerne la structure même du diagnostic psychiatrique : faut-il continuer à adopter un modèle catégoriel, ou évoluer vers une approche plus dimensionnelle ? Le modèle catégoriel actuel, où l’on considère qu’une personne remplit ou non les critères d’un trouble, a longtemps été privilégié pour sa facilité d’usage clinique, en particulier pour guider les décisions thérapeutiques binaires. Cependant, certains symptômes psychiatriques comme l’anhédonie (ndlr : absence de plaisir) ou les troubles cognitifs apparaissent dans de multiples troubles et ne correspondent pas clairement à un diagnostic unique. Le comité explore donc la possibilité de rendre cela plus explicite dans le futur DSM afin de favoriser une approche thérapeutique plus personnalisée.
Un autre axe de réflexion concerne l’élaboration d’un cadre général dans lequel les diagnostics seraient regroupés en classes plus larges, en conservant peut-être certains intitulés de chapitres actuels comme catégories englobantes, ou en recourant à d’autres structures, comme les troubles « internalisés » et « externalisés ». Au sein de ces catégories générales, il y aurait probablement des sous-types correspondant aux diagnostics actuels.
Un autre domaine d’intérêt majeur est l’intégration potentielle de données biologiques dans la classification psychiatrique. Lorsque le DSM a adopté son format actuel en 1980, la psychiatrie biologique en était encore à ses débuts, et le manuel avait délibérément évité de faire des hypothèses théoriques sur la causalité. Depuis, la discipline a progressé de manière significative, et il est désormais largement admis que les troubles mentaux résultent d’interactions complexes entre le fonctionnement cérébral et des facteurs internes et externes.
L’objectif actuel est d’examiner comment des indicateurs biologiques, comme des signatures génétiques, des biomarqueurs ou l’imagerie cérébrale, pourraient contribuer à affiner les diagnostics ou à définir des sous-types pertinents de troubles. Même si ces marqueurs ne sont pas encore suffisamment spécifiques pour constituer des critères diagnostiques autonomes, ils pourraient enrichir le processus diagnostique et déboucher sur des traitements plus personnalisés. Tout au long de ces travaux, le comité reste conscient du rôle central du DSM dans la prise en charge des patients. Toute modification conceptuelle ou structurelle doit donc être mise en œuvre avec prudence, pour éviter de perturber la pratique clinique ou l’accès aux soins. Trouver l’équilibre entre innovation scientifique et applicabilité réelle est l’un des principaux défis du futur de la psychiatrique.
Le comité prend également en compte des dimensions comme la qualité de vie, le fonctionnement et le contexte social. Comment ces éléments, associés à une évolution vers un modèle de « document vivant » avec des mises à jour plus fréquentes, pourraient-ils transformer l’usage pratique et les fondements conceptuels du DSM ?
Un domaine clé de la nouvelle édition concerne l’intégration des déterminants sociaux de la santé, en cohérence avec le cadre élargi promu par l’Organisation mondiale de la santé. Cette perspective englobe non seulement les conditions matérielles comme le logement, la précarité alimentaire, la pauvreté ou l’éducation, mais aussi les environnements culturel, développemental, familial, etc.
L’objectif est d’adopter une vision véritablement mondiale, afin d’accroître la pertinence du manuel et de renforcer les échanges avec les chercheurs, les cliniciens et les acteurs engagés dans ces problématiques essentielles.
Un autre point important concerne le fonctionnement et la qualité de vie, des dimensions considérées comme sous-représentées dans le DSM-5. Les versions précédentes, notamment le DSM-3 et le DSM-4, comportaient un système multi-axial permettant aux cliniciens de documenter non seulement les diagnostics principaux, mais aussi les troubles de la personnalité, les affections médicales concomitantes, les facteurs de stress et une mesure globale du fonctionnement.
Bien que ce système ait montré des limites en termes de validité et de fiabilité, un regain d’intérêt existe pour réintroduire des mesures du fonctionnement qui soient à la fois robustes scientifiquement et utiles cliniquement. Nous envisageons actuellement des échelles alternatives susceptibles de mieux mesurer la qualité de vie et le fonctionnement, et que nous pourrions recommander à l’avenir.
Au-delà de leur fiabilité et solidité psychométrique (ndlr : Science des mesures pratiquées en psychologie incluant les modalités de validation et d’élaboration de ces mesures), nous prêtons également attention à leur aspect pratique, notamment leur accessibilité. Leur disponibilité gratuite est un critère essentiel, car nous souhaitons que les outils proposés soient utilisables à l’échelle mondiale.
Pourriez-vous décrire comment le comité stratégique est structuré et quelle est la feuille de route, depuis les réflexions initiales jusqu’à la publication et aux futures mises à jour du DSM ?
Nous sommes encore en train de définir précisément la feuille de route. À ce stade, un comité de pilotage et quatre sous-comités ont été constitués, rassemblant un groupe restreint de personnes. À mesure que le modèle se précise, nous élargirons la structure en créant des comités supplémentaires afin de garantir une expertise suffisante pour couvrir toutes les catégories diagnostiques et présentations cliniques. Cela sera essentiel pour intégrer les avancées scientifiques les plus récentes et identifier les prochaines étapes.
Nous espérons finaliser la feuille de route d’ici début 2026. Une fois celle-ci établie, commencera la phase allant de la cartographie des troubles jusqu’au design de la nouvelle structure du DSM, accompagnée de la désignation des comités chargés du travail approfondi.
En parallèle, il est crucial de recueillir les retours du terrain. Nous souhaitons rester à l’écoute des interrogations et critiques, afin d’intégrer de manière significative les voix des cliniciens et des personnes concernées par les troubles psychiques. L’expérience vécue, qu’elle soit clinique ou personnelle, est une source précieuse, qui permettra d’ancrer nos recommandations dans la réalité du terrain pour les professionnels comme pour les patients.
Le processus d’approbation du DSM implique également plusieurs niveaux d’engagement au sein de l’American Psychiatric Association (APA). Le fait que certains membres de notre comité aient une connaissance approfondie de la structure de l’APA est un atout majeur. Par exemple, le rôle précédent de Jonathan Alpert en tant que président du Council on Research, et ma propre expérience en tant que présidente de l’APA, nous offrent un réseau de confiance et une compréhension fine des dynamiques institutionnelles, des éléments que nous espérons mobiliser utilement. Nous souhaitons instaurer un dialogue constructif, indispensable à une adoption large et cohérente des résultats de ce processus.