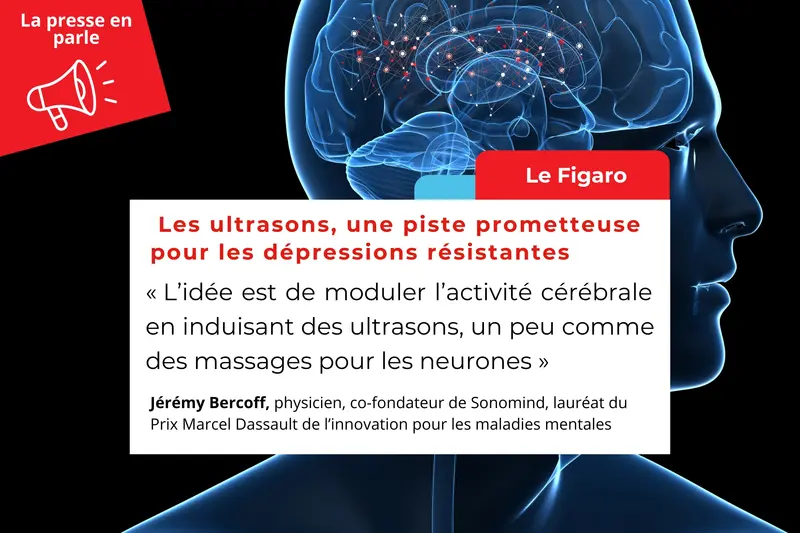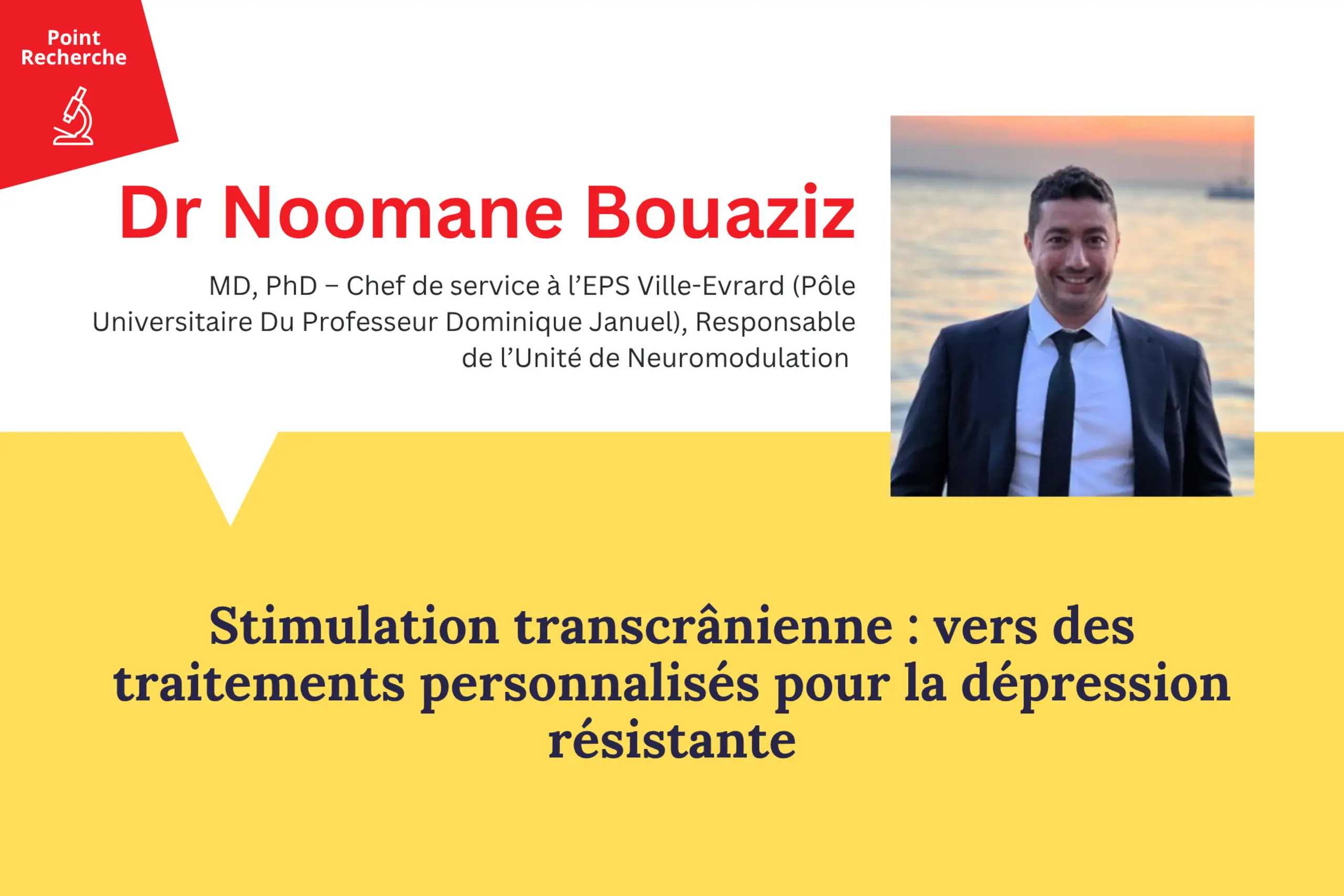
Stimulation transcrânienne : vers des traitements personnalisés pour la dépression résistante
Dr Noomane Bouaziz
MD, PhD – Chef de service à l’EPS Ville-Evrard (Pôle Universitaire Du Professeur Dominique Januel), Responsable de l’Unité de Neuromodulation
Stimulation transcrânienne : vers des traitements personnalisés pour la dépression résistante
La dépression est une pathologie fréquente, potentiellement sévère, qui demeure résistante aux traitements psychothérapeutiques et médicamenteux dans 20 à 30 % des cas. L’électro-convulsivothérapie (ECT) constitue le traitement de référence dans ces formes résistantes. Toutefois, son accessibilité est limitée en raison de la nécessité d’une anesthésie générale, des effets cognitifs secondaires possibles, et d’une stigmatisation persistante dans la population générale.
Parmi les alternatives émergentes, la stimulation transcrânienne par courant continu (tDCS) représente une technique de neuromodulation non invasive, bien tolérée, peu coûteuse et facilement applicable, y compris à domicile. Elle repose sur l’application d’un courant de faible intensité (2 mA, 9 volts) délivré via deux électrodes positionnées sur le cuir chevelu, permettant de moduler l’excitabilité neuronale.
Dans le cadre du traitement de la dépression, les électrodes sont généralement placées sur les zones du scalp se projetant sur le cortex préfrontal dorsolatéral (DLPFC), une région clé impliquée dans la régulation de l’humeur. Bien que plusieurs études aient mis en évidence le potentiel thérapeutique de la tDCS, les résultats demeurent hétérogènes. En outre, le niveau de preuve de son efficacité reste inférieur à celui de l’ECT ou de la stimulation magnétique transcrânienne (TMS), autre technique de neuromodulation validée dans les troubles dépressifs.
Cette variabilité pourrait notamment s’expliquer par l’utilisation de protocoles de stimulation reposant sur des montages standardisés de placement des électrodes, ne tenant pas compte des variations de l’anatomie cérébrale entre les individus. Afin d’explorer cette hypothèse, nous avons mené une revue systématique de la littérature accompagnée d’une méta-analyse, complétée par une simulation des courants induits à l’aide du logiciel SimNibs, basé sur la modélisation par éléments finis. L’ensemble des simulations a été réalisé à partir de six IRM cérébrales structurelles.
Les résultats montrent que le cortex préfrontal dorsolatéral gauche, bien que cible principale des protocoles, n’est pas systématiquement atteint par le courant. Celui-ci se diffuse de manière plus étendue que prévu, stimulant également d’autres régions cérébrales. La corrélation entre l’amélioration clinique et les régions effectivement traversées par le courant suggère l’implication possible de structures non intentionnellement ciblées, mais déjà reconnues dans la littérature pour leur rôle dans la régulation affective.
Ces données renforcent l’intérêt d’une approche individualisée du positionnement des électrodes, visant à optimiser la distribution du courant et à améliorer l’efficacité thérapeutique. Elles suggèrent également que les effets antidépresseurs de la tDCS pourraient reposer sur la modulation d’un réseau fonctionnel plus large que le seul cortex préfrontal dorsolatéral, contribuant ainsi à une meilleure compréhension de la physiopathologie de la dépression et au développement de stratégies de neuromodulation véritablement personnalisées.