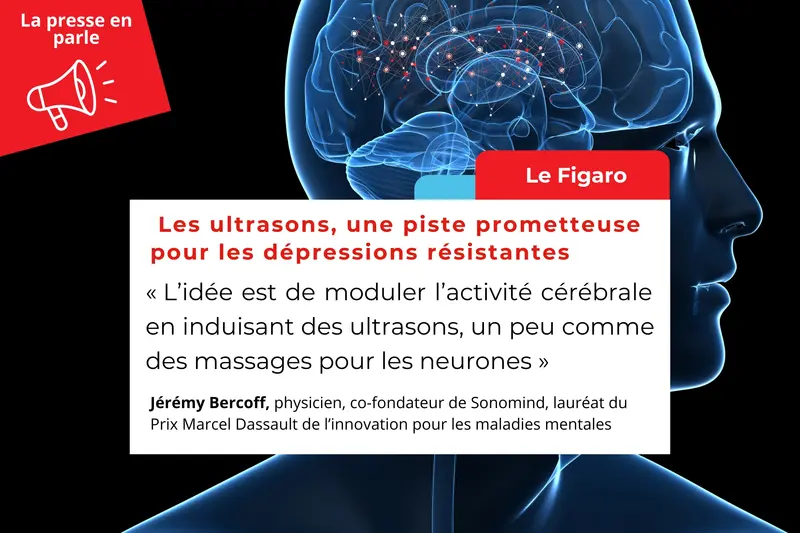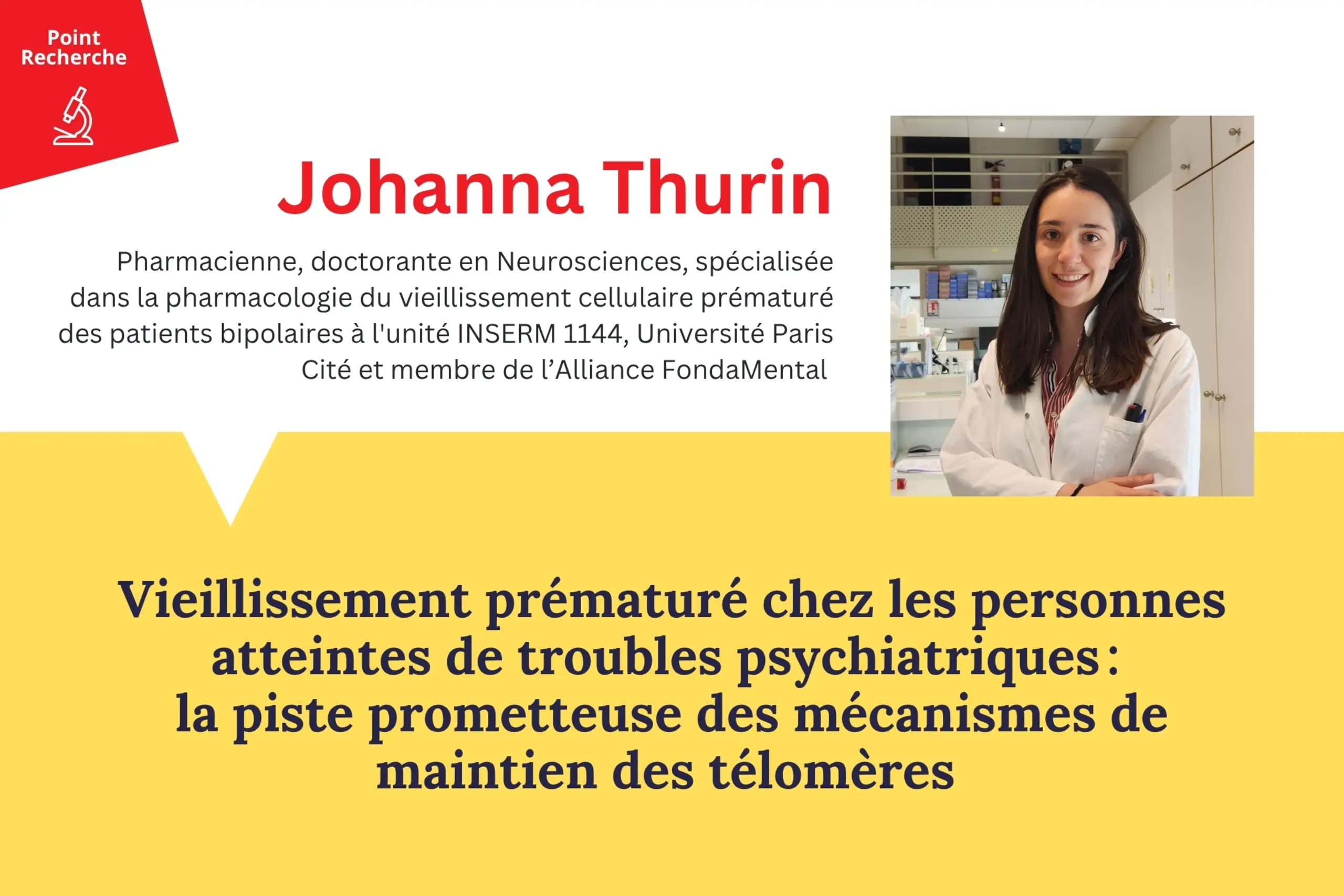
Vieillissement prématuré chez les personnes atteintes de troubles psychiatriques : la piste prometteuse des mécanismes de maintien des télomères
Johanna Thurin
Pharmacienne, doctorante en Neurosciences, spécialisée dans la pharmacologie du vieillissement cellulaire prématuré des patients bipolaires à l’unité INSERM 1144, Université Paris Cité et membre de l’Alliance FondaMental
Un vieillissement prématuré observé
L’impact des troubles psychiatriques majeurs sur la santé globale suscite un intérêt croissant, notamment en raison de leur prévalence élevée dans la population. La dépression majeure concerne en effet 15 à 20% des individus, la schizophrénie en affecte environ 1%, tandis que les troubles bipolaires touchent entre 1% et 2,5% de la population.
Les personnes atteintes de ces troubles ont une espérance de vie réduite, avec un risque accru de suicide mais également de maladies somatiques liées à l’âge comme les maladies cardiovasculaires ou les cancers pulmonaires et digestifs. Cette vulnérabilité a conduit à formuler l’hypothèse d’un vieillissement cellulaire prématuré chez ces patients. Parmi les indicateurs les plus étudiés du vieillissement biologique figure la longueur des télomères. Ces séquences d’ADN situées aux extrémités des chromosomes les protègent et raccourcissent naturellement au cours du vieillissement. Cette longueur des télomères a été montrée comme étant plus courte chez les patients atteints de ces troubles psychiatriques majeurs, comparativement à la population générale. Cependant les mécanismes en jeu restent encore largement méconnus.
Le mécanisme de maintien des télomères, une piste prometteuse
Dans ce contexte, nous avons réalisé une revue des études qui analysent les mécanismes impliqués dans le maintien de la longueur des télomères chez des individus atteints de dépression majeure, schizophrénie ou de trouble bipolaire. Nous nous sommes intéressés notamment à l’activité de la télomérase, une enzyme qui permet de maintenir la taille des télomères, ainsi qu’à l’influence de facteurs génétiques, de l’expression des gènes et des interventions thérapeutiques — médicamenteuses ou non.
Nous avons ainsi identifié 25 études, dont la majorité portait sur la dépression (16 études). La télomérase apparaît comme le biomarqueur le plus souvent étudié. Cinq études sur sept montrent que son activité est plus élevée chez les sujets atteints de dépression majeure. Les essais cliniques identifiés exploraient divers types d’interventions, allant des antidépresseurs à la sismothérapie en passant par des approches alternatives comme le yoga. Toutefois, la grande hétérogénéité des méthodologies complique l’interprétation des résultats.
Dans l’ensemble, les données de la littérature suggèrent que l’activité de la télomérase est plus élevée chez les personnes atteintes de dépression majeure, sans modification notable par les traitements. En revanche, il y a trop peu d’études sur la schizophrénie et le trouble bipolaire pour en tirer des conclusions robustes.
Aujourd’hui, il reste encore beaucoup à découvrir. La recherche actuelle reste limitée, car elle ne prend pas assez en compte la complexité des mécanismes de maintien des télomères. Il faudrait donc mener des études plus larges, mieux structurées, et qui analysent plus en détail les différents aspects de ces mécanismes dans ces trois troubles. A terme, ces recherches pourraient nous permettre d’identifier de nouvelles stratégies thérapeutiques adaptées aux patients pour leur offrir une meilleure espérance de vie.